Le défi structurel auquel fait face la culture africaine
À travers l’Afrique, la visibilité culturelle a cessé d’être un phénomène marginal, non pas à la suite d’un éveil soudain ou d’un moment de rupture isolé, mais parce que la musique, le cinéma et les cultures numériques en direct circulent désormais avec une rapidité et une portée qu’il aurait été difficile d’imaginer il y a encore dix ans. La musique traverse rapidement les frontières et les plateformes, les films circulent de plus en plus facilement au-delà de leurs pays d’origine, et les publics se rassemblent autour de moments numériques en direct d’une manière qui rappelle de plus en plus les rituels collectifs des concerts, des salles de cinéma et des festivals, formant ainsi un espace public continental qui n’est ni passif ni périphérique.
 Des spectateurs lors de l’édition 2025 du festival Sauti za Busara à Zanzibar. Photo: SzB
Des spectateurs lors de l’édition 2025 du festival Sauti za Busara à Zanzibar. Photo: SzB
Cette intensité collective a été particulièrement visible lors de la récente tournée africaine du streamer iShowSpeed, dont les diffusions en direct ont attiré des centaines de milliers de spectateurs simultanés dans plusieurs villes africaines. L’importance de ce moment tenait moins à l’individu derrière la caméra qu’au comportement qu’il révélait. Les publics suivaient en temps réel, se rassemblaient physiquement autour du flux et amplifiaient instantanément les images sur les plateformes, reproduisant les dynamiques du spectacle vivant, de la télévision de diffusion et de la culture festivalière. Ce qui pouvait sembler, à première vue, être un simple spectacle numérique relevait en réalité d’un schéma culturel familier, déployé cette fois sur une plateforme mondiale.
Pourtant, pour de nombreux musiciens, cinéastes, managers et travailleurs culturels, cette visibilité demeure étrangement creuse. Les flux augmentent, les foules se rassemblent, les images circulent à l’échelle mondiale, mais les circuits de tournée restent précaires, les redevances arrivent de manière irrégulière, et les projets peinent à passer de l’élan à la continuité. Ce qui ressemble, de l’extérieur, à un succès se traduit souvent, de l’intérieur, par une instabilité persistante.
Cette tension définit aujourd’hui une grande partie de l’économie culturelle contemporaine africaine. Il ne s’agit pas d’un manque de talent, de créativité ou d’appétit du public, mais d’un problème d’organisation. L’attention existe à grande échelle, mais les systèmes nécessaires pour transformer cette attention en une industrie durable demeurent inégaux, fragmentés, voire inexistants.
En résumé, l’Afrique ne manque pas de publics. Elle manque des structures qui permettent à l’attention de se transformer en stabilité.
La culture comme infrastructure productive
Dans les marchés qui perdurent, la culture n’est pas considérée uniquement comme une forme d’expression ou d’affirmation identitaire, mais comme une infrastructure productive. La musique et le cinéma fonctionnent comme des systèmes de travail, des systèmes de marché et des systèmes institutionnels qui exigent une continuité dans le temps. La valeur ne naît pas de moments isolés de réussite, mais d’une interaction soutenue entre création, circulation, droits et réinvestissement.
Cette distinction est particulièrement importante dans les contextes africains. Là où l’activité culturelle est principalement envisagée comme une succession d’événements ponctuels ou comme un outil de promotion à court terme, le succès apparaît brièvement puis s’évanouit. Là où elle est pensée comme une infrastructure, elle s’accumule. L’infrastructure ne se limite pas aux studios ou aux équipements. Elle comprend des circuits de tournée permettant aux artistes de se produire régulièrement, des réseaux de diffusion et de projection qui prolongent la vie des films au-delà de leur sortie initiale, des systèmes de droits garantissant la rémunération des créateurs lorsque leurs œuvres sont utilisées, des mécanismes de commande qui réduisent le risque avant que la visibilité n’atteigne son sommet, ainsi que des systèmes de données qui rendent l’activité économique visible.
Dès lors, la question centrale n’est pas de savoir si la culture africaine circule à l’échelle mondiale. Elle le fait indéniablement. La question plus complexe est de déterminer si les systèmes locaux sont suffisamment solides pour retenir la valeur lorsque ces œuvres franchissent les frontières.
Les instruments continentaux africains reconnaissent déjà la culture comme un moteur de développement, d’emploi et d’intégration. Le Plan d’action de l’Union africaine pour les industries culturelles et créatives appelle explicitement au renforcement des chaînes de valeur, à la création de marchés durables et à l’amélioration des conditions de travail des créateurs. La Charte pour la renaissance culturelle africaine va plus loin en plaçant la culture au cœur de la transformation économique et de la souveraineté africaine sur ses ressources créatives. Le défi ne réside pas dans la formulation de ces ambitions, mais dans leur mise en œuvre.
Des écosystèmes plutôt que des secteurs isolés
Les créateurs africains vivent rarement l’économie culturelle comme une juxtaposition de secteurs distincts. Dans la pratique, elle fonctionne comme un écosystème. La musique nourrit le cinéma à travers les bandes originales et les compositions. Les clips musicaux façonnent les langages visuels. Le spectacle vivant stimule la découverte numérique. Les festivals servent simultanément de scènes de performance, de lieux de projection, d’espaces de mise en réseau et de points d’entrée sur le marché. Les publics naviguent aisément entre l’audio, la vidéo, les événements en direct et les plateformes en ligne, souvent au sein d’un même moment culturel.
Les politiques publiques et les investissements, en revanche, ne reflètent pas toujours cette réalité. La musique, le cinéma, la radiodiffusion, le spectacle vivant et les contenus numériques continuent d’être traités comme des domaines séparés, relevant de ministères, de réglementations et de mécanismes de financement distincts. Il en résulte un décalage. Artistes, lieux, festivals, plateformes, sociétés de gestion des droits, financeurs et publics interagissent quotidiennement, mais rarement à travers des calendriers partagés, des normes communes ou des marchés interconnectés. L’activité est intense, mais la création de valeur à long terme demeure difficile. L’écosystème existe dans les faits, mais pas encore dans sa structuration.
Ce schéma est observable à travers le continent. Au Kenya, les clips musicaux et les sessions live connaissent un fort succès en ligne, tandis que les revenus du spectacle vivant restent imprévisibles et peu documentés. En Afrique du Sud, des infrastructures de lieux et de droits plus solides ont permis une plus grande stabilité des revenus, bien que l’accès demeure inégal. Au Nigeria, une circulation régulière entre le cinéma, la télévision, la musique et les plateformes numériques a permis le développement des marchés nationaux avant l’exportation mondiale.
En Afrique de l’Ouest francophone, les marchés linguistiques partagés ont facilité la circulation régionale. En Côte d’Ivoire, la musique et les œuvres audiovisuelles circulent aisément au-delà des frontières grâce aux diffuseurs, aux festivals et aux canaux numériques. Au Mali, une forte identité culturelle et des traditions vivantes de performance soutiennent la demande, mais des infrastructures de tournée limitées et une collecte des droits insuffisante continuent de restreindre les revenus malgré une participation élevée. L’Afrique du Nord offre une autre configuration, où des systèmes de diffusion établis favorisent la circulation, tandis que les créateurs indépendants peinent à accéder aux marchés.
Ces différences ne relèvent pas du talent. Elles tiennent à l’organisation des systèmes.
Lorsque les systèmes sont alignés, les résultats s’améliorent.
Pourquoi la visibilité devient rarement un moyen de subsistance
Lorsque la popularité ne se traduit pas en revenus, ce n’est généralement pas un hasard. Dans une grande partie de l’Afrique, la musique et le cinéma atteignent les publics principalement par l’intermédiaire de plateformes mondiales conçues pour l’échelle et l’efficacité publicitaire, plutôt que pour le développement de marchés locaux. Ces plateformes élargissent la portée, mais elles ne créent pas de circuits de tournée, ne soutiennent pas des chaînes de commande régulières, ne formalisent pas les économies du spectacle vivant et ne renforcent pas l’application des droits au niveau national.
Il en résulte que l’attention progresse plus vite que les revenus. Les écoutes et les vues augmentent, tandis que les gains restent incertains. Les événements en direct attirent des foules sans rémunérations cohérentes ni mécanismes fiables de déclaration. Les films sont projetés, puis disparaissent faute de circuits de diffusion durables. La production créative est florissante, mais les retombées économiques se dispersent.
Les données relatives aux redevances confirment ce déséquilibre. Les droits de représentation publique et audiovisuels sont collectés bien en deçà de leur potentiel sur une grande partie du continent, non parce que l’activité est absente, mais parce qu’elle demeure informelle, insuffisamment mesurée et faiblement appliquée.
Pour les créateurs, cette contradiction se vit au quotidien. Les salles se remplissent, les moyens de subsistance restent fragiles, les moments viraux se multiplient sans lendemain. Le succès semble proche, mais il est difficile à reproduire.
C’est cette pression silencieuse qui façonne aujourd’hui le travail culturel en Afrique.
Les marchés se construisent, ils ne se sauvent pas
Si la visibilité suffisait à elle seule à soutenir les industries culturelles, les secteurs africains de la musique et du cinéma seraient déjà parmi les plus stables au monde. L’écart persistant entre attention et subsistance indique qu’un enjeu plus structurel est en jeu.
Les marchés durables ne naissent pas par accident et ne se stabilisent pas uniquement par l’élan. Ils sont construits de manière délibérée, par la planification, la coordination et un engagement institutionnel constant, souvent bien avant que le succès ne devienne visible. Or, dans une grande partie de l’Afrique, les politiques culturelles demeurent réactives. Le soutien intervient après un succès, une crise ou un pic d’attention, plutôt qu’en amont.
Construire des marchés solides implique de déplacer l’attention des projets vers les trajectoires. Cela suppose de privilégier la circulation avant l’exportation, la commande avant la médiatisation, et les systèmes de droits avant l’expansion à grande échelle. Cela implique également d’investir tôt dans les circuits de tournée, les réseaux de diffusion, les lieux et les systèmes de licences, afin que les créateurs ne portent pas seuls l’ensemble des risques.
Là où cette logique a été appliquée, même de manière imparfaite, les résultats sont visibles. Les secteurs nigérians de la musique et du cinéma se sont développés en servant leurs publics nationaux de façon constante. Les marchés francophones ont mobilisé les langues partagées, les diffuseurs régionaux et les financements transfrontaliers pour dépasser les limites de l’échelle nationale.
L’enjeu n’est pas la perfection, mais l’intention.
À quoi ressemblent des systèmes fonctionnels
Les systèmes culturels qui fonctionnent sont faciles à reconnaître. Les artistes tournent régulièrement. Les festivals sont connectés plutôt qu’isolés, avec des calendriers coordonnés qui permettent la circulation entre villes et pays. Les données sont enregistrées, et non estimées.
Lorsque les ventes de billets, les chiffres de fréquentation, les diffusions et les redevances sont correctement suivis, les banques et les institutions financières gagnent en confiance. Le risque devient mesurable. L’investissement devient possible. En l’absence de données, la culture demeure difficile à financer, quelle que soit sa popularité.
Le leadership est tout aussi déterminant. Dans de nombreux pays africains, les portefeuilles des arts et de la culture sont perçus comme des récompenses politiques plutôt que comme des responsabilités techniques. Lorsque la direction manque de connaissance sectorielle, les politiques deviennent symboliques et éphémères. À l’inverse, un leadership informé peut aligner la culture avec la planification économique, le tourisme, l’éducation et le commerce.
La conception institutionnelle influence également les résultats. Les pays disposant d’agences culturelles dédiées sont mieux armés pour mettre en œuvre les politiques, collecter des données et coordonner les marchés. Là où la culture est diluée au sein de ministères aux mandats larges, elle entre en concurrence avec d’autres priorités et perd souvent en visibilité.
La régulation des droits est tout aussi essentielle. La majorité des sociétés de gestion collective en Afrique sont privées. Une régulation efficace doit protéger les créateurs sans fragiliser les systèmes de collecte. Le Kenya offre un exemple édifiant, où des conflits prolongés entre régulateurs et sociétés de gestion ont affaibli la collecte et la confiance, au détriment des artistes. Lorsque la régulation devient conflictuelle plutôt que facilitatrice, les créateurs en subissent les conséquences.
Lorsque ces éléments fonctionnent ensemble, la croissance se renforce. Lorsqu’ils font défaut, le succès dépend du hasard.
L’avenir culturel de l’Afrique ne sera pas décidé par la visibilité seule. Les publics sont déjà présents, ils écoutent, regardent, partagent et participent à grande échelle. La responsabilité incombe désormais aux gouvernements, aux institutions régionales et aux acteurs du marché de construire les systèmes qui permettront au travail culturel de durer plutôt que de simplement apparaître.
Lucy Ilado est praticienne du développement culturel basée à Nairobi, au Kenya. Elle travaille à l’intersection des médias, de la recherche et du plaidoyer en matière de politiques publiques dans les industries culturelles et créatives. Les opinions exprimées ici sont les siennes et ne reflètent pas nécessairement la position de la publication.















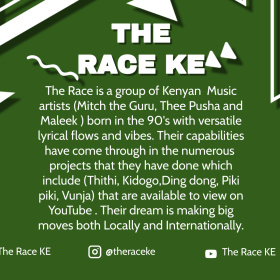










Comments
Log in or register to post comments