Lebowa : Danser au rythme du tambour
Lebowa signifie « le nord » : une direction, un lieu, un nom qui porte la fierté du peuple Bapedi. Dire lebowa, c’est revendiquer nos racines dans le nord de l’Afrique du Sud, au Limpopo, là où notre identité bat comme un tambour.
 Le tambour djembé. Photo : Paul Zoetemeijer sur Unsplash.
Le tambour djembé. Photo : Paul Zoetemeijer sur Unsplash.
Ainsi, notre danse s’appelle lebowa, un hommage à ce que nous sommes et à l’endroit d’où nous venons. Danser le lebowa (Go bina) revient à suivre une rivière qui a traversé des générations de femmes Bapedi, portant nos histoires, nos identités et le pouvoir de reprendre notre place dans la société.
Originaire de la province du Limpopo, au sein du peuple Bapedi, le lebowa est une danse traditionnelle exclusivement féminine qui a longtemps servi de symbole culturel d’unité et d’identité. Elle est profondément ancrée dans la participation communautaire – tambours, chants, mouvements expressifs et tenues symboliques.
Le lebowa joue un rôle essentiel lors de divers événements culturels tels que les mariages, les rituels, les cérémonies ancestrales et les rites d’initiation féminins. La danse est souvent présentée lors de rassemblements culturels, où elle agit à la fois comme une pratique sociale et spirituelle.
Le lebowa est aussi un moyen de communication au sein de la communauté, car ses chants servent souvent de forme de réprimande sociale. Par exemple, une chanson populaire, Sebodu sa bo Mmashela, est chantée pour moquer les filles paresseuses qui se lèvent tard, souvent avec une pointe de sarcasme. Cette chanson, en particulier, m’est devenue familière lorsque j’étais enfant : ma grand-mère me la chantait chaque fois que je me levais après le lever du soleil.
Danser le lebowa (go bina) implique des battements de mains, des youyous, du chant et de la danse, mais son essence réside dans les meropa (tambours). L’ensemble de tambours comprend trois instruments : le tambour-mère, le plus grand, généralement joué par une femme plus âgée, et deux tambours-sœurs, qui suivent le rythme du tambour-mère. Cette structure symbolise la hiérarchie familiale, où les filles doivent écouter et suivre les conseils de la mère.
Les meropa sont au cœur de notre identité culturelle en tant que peuple Bapedi, et ils sont particulièrement importants lors de nos cérémonies, servant de moyen de connexion avec nos ancêtres.
Certains des chants interprétés pendant le lebowa sont également chantés lors de la danse masculine dinaka, démontrant l’héritage culturel et linguistique commun des traditions musicales Bapedi. L’une de ces chansons est Kgetsi Lesaka, traditionnellement chantée lors de récoltes abondantes. Les mots kgetsi et lesaka signifient tous deux « sac », symbolisant des sacs remplis de maïs ou de sorgho – signe d’abondance et de prospérité.
Cependant, au-delà de la célébration du succès agricole, cette chanson agit aussi comme un pont linguistique et culturel au sein du peuple Bapedi. L’inclusion des deux mots kgetsi et lesaka dans un même chant met en lumière l’interaction entre différentes variations dialectales du paysage linguistique Bapedi. Ces termes proviennent de variations du Sepedi, historiquement appelé Sesotho sa Leboa ou Sotho du Nord selon les contextes.
En utilisant les deux mots, la chanson reconnaît et traverse les divisions linguistiques existantes au sein du peuple Bapedi. Elle favorise l’inclusivité en veillant à ce que les locuteurs de différents dialectes s’y reconnaissent, renforçant ainsi un sentiment d’unité entre les communautés Bapedi de diverses régions. Dans le même temps, l’usage de mots différents pour désigner un même concept peut créer de subtiles formes d’exclusion, soulignant des distinctions linguistiques qui reflètent des différences historiques, géographiques et sociales.
Danser le lebowa dans son ensemble joue un rôle clé dans le renforcement d’une identité Bapedi collective au-delà des frontières régionales et dialectales. La danse, pratiquée dans diverses parties du Limpopo et même au-delà, devient une pratique culturelle partagée qui unit les femmes par le mouvement, le rythme et le chant.
Quel que soit le dialecte parlé dans une communauté donnée, le lebowa offre un espace où la langue devient secondaire face à l’expérience incarnée de la danse et des percussions. La structure même des tambours – avec le tambour-mère en tête et les tambours-sœurs qui suivent – reflète les principes d’unité, de hiérarchie et de participation collective qui définissent l’organisation sociale Bapedi.
De plus, la danse intègre des chants qui abordent les préoccupations communautaires, les événements historiques et les expériences quotidiennes, en faisant une tradition vivante qui reflète la vie contemporaine des Bapedi. Ce faisant, le lebowa ne se contente pas de préserver le patrimoine culturel des femmes Bapedi, il façonne activement et réaffirme l’identité Bapedi face à la diversité linguistique et régionale.
Au cœur du lebowa se trouve le tambour – meropa – le pouls puissant de la tradition, de la culture et de l’identité Bapedi. Plus qu’un instrument de musique, le tambour est une archive vivante de notre histoire, un réceptacle sacré qui porte les voix de nos ancêtres jusqu’au présent. C’est grâce aux meropa que la danse trouve son rythme, que les histoires se racontent et que des générations de femmes Bapedi revendiquent fièrement leur place dans la continuité de la mémoire culturelle. Le tambour-mère, qui guide avec sagesse et autorité, reflète le rôle des matriarches dans l’orientation et la structuration de la communauté, tandis que les tambours-sœurs résonnent comme la force collective et la résilience des femmes avançant ensemble à l’unisson. À chaque battement, il y a un appel à se souvenir, à honorer et à préserver – non seulement la musique mais l’esprit d’unité, de fierté et de résilience profondément enraciné dans la féminité Bapedi. Ainsi, le lebowa est bien plus qu’une danse : c’est un acte de préservation culturelle, une déclaration rythmique d’identité et un témoignage du pouvoir durable des meropa pour maintenir vivant le passé dans le présent.
Comme nous le dirions en Sepedi : Sa kosha ke lerole ! (La poussière est le rythme du chant !) Moropa ga o lle ! (Que le tambour résonne !).
Tsosheletso Chidi est écrivaine, poétesse et commissaire littéraire, titulaire d’un doctorat en langues africaines de l’Université de Pretoria. Ses recherches portent sur les langues autochtones et leur rôle dans la construction du sens social, notamment dans les représentations de l’homosexualité. Elle a publié de nombreux ouvrages, dont son roman The Baby Is Born (2015), Dirurubele-Wandering Butterflies (2024) et des traductions du poème choréographique Loss-Ilahleko. Elle a dirigé le Time of the Writer Festival 2024 et milite pour les écrivains émergents et les langues autochtones.
Cet article a été originalement écrit et publié en anglais dans le cadre du Projet de fabrication et de réparation d’instruments.




















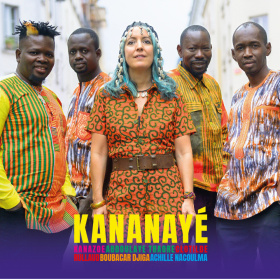









Commentaires
s'identifier or register to post comments