Sakifo & IOMMa : 2025 sous le signe d’une sono mondiale panafricaine et féminine
L’île de La Réunion a vibré aux rythmes de deux événements majeurs, le IOMMa et le Sakifo, qui ont réaffirmé pour cette année 2025 leur rôle de catalyseurs culturels dans l’Océan Indien. Une édition marquée par une sono-mondiale vibrante à l’image d'un line-up pointu, féminin incarnant l’avenir artistique des Mascareignes. Rencontres, concerts, podcasts et art-ivisme enregistrés dans mes micros.
 Flombola à La Salle Verte - © Cédric Demaison
Flombola à La Salle Verte - © Cédric Demaison © Olivier Padre
© Olivier Padre Emlyn - © Cédric Demaison
Emlyn - © Cédric Demaison Kiltir à la Salle Verte - © Cédric Demaison
Kiltir à la Salle Verte - © Cédric Demaison Nagaï - © Cédric Demaison
Nagaï - © Cédric Demaison
Quand je foule le sable réunionnais pour la quatrième fois – et la première avec Music In Africa – je sens que ce reportage ne sera pas comme les autres. Il sera ancré, en adéquation avec l’ADN du média. La Réunion, c’est une île-mémoire, profondément liée aux héritages africains. Ici, les musiques viennent de loin. Elles ont traversé l’océan enchaînées, portées par des rythmes de survie, devenues musiques de combat. Le Maloya en est l’âme vivante : interdit hier, pilier aujourd’hui, et forcément genre musical essentiel de ces deux événements. Son tambour typique, le roulèr, se fait entendre dès ma sortie de l’aéroport. Ici, l’énergie est dense, électrique, presque familière. Le IOMMa (Indian Ocean Music Market), plus grand marché des musiques de l’Océan Indien, et le Sakifo, qui entame sa troisième décennie, donnent le ton.
IOMMa 2025 : le panafricanisme résonne dans l’Océan Indien
Du 3 au 5 juin 2025, les professionnels des musiques du monde se sont retrouvés à La Réunion pour ce rendez-vous devenu incontournable. À peine le temps de poser mes affaires dans l’hôtel familial Le Lindsey que je discute déjà avec quelques membres d’une délégation venue du continent : 18 professionnels, issus de 13 pays africains, rassemblés pour le IOMMa. On grimpe dans un bus direction la Plaine des Cafres sur la commune du Tampon pour assister au cabaret d’un groupe légendaire : Pat’Jaune. Leur musique est un mélange singulier — danses d’antan (valses, polkas, importés par les premiers colons), séga des bas, et une touche cadienne avec banjo et violon qui rappelle la Louisiane. Ils chantent le quotidien des Yabs, ce peuple des hauts, venus après les Marrons. Sur ces airs métissés, pleins de mélancolie et d’ironie douce, on partage un repas local préparé avec soin. L’ambiance est posée. Imprégné, un peu chaviré déjà, on échange sur le retour vers Saint-Pierre. Les showcases s’annoncent pour les trois soirs à venir. L’intensité monte doucement.
Le soir, direction le Kervéguen, salle emblématique de Saint-Pierre. L’ambiance est à la fois pro et chaleureuse : retrouvailles entre journalistes, programmateur·ices, bookers, musicien·nes, labels… Une atmosphère quasi familiale, qui témoigne de la rareté et de la force de ce marché. L’Afrique et ses diasporas y sont représentées avec dignité. C’est le Sud-Africain Sibusile Xaba qui ouvre le bal. Sa folk est contagieuse. Entre vertiges rythmiques et envolées scattées, il improvise avec une voix à fleur de peau, mélancolique, habitée. Il s’inscrit dans la lignée du jazz sud-africain, celui qui transcende les frontières du genre. Le souffle panafricain se poursuit avec les artistes sélectionné·es en showcases. Lenna Bahule, chanteuse, percussionniste corporelle et éducatrice artistique venue du Mozambique, livre une musique spirituelle, ancrée dans les rythmes traditionnels de son pays. À ses côtés, des musiciens brésiliens. Le lien avec l’Atlantique noir est clair. Elle chante en plusieurs langues africaines et navigue entre Afrique, Caraïbes et Océan Indien — un voyage sonore qui emporte un public conquis. Très attendue, Sueilo confirme : elle est l’une des étoiles montantes de l’afro-pop réunionnaise. Avec une aisance déconcertante, elle pose ses timbres et ses flows aussi bien sur de l’amapiano que du shatta ou de l’afrobeats. Elle incarne cette nu-gen réunionnaise, prête à rayonner bien au-delà de l’île. Et puis, “Singeli to the world”. La devise est claire. Depuis les ghettos de Dar es Salaam, les artistes tanzaniens font vibrer cette street music ultra rapide et débridée. Man Fongo, figure de ce mouvement, a clôturé la soirée avec une énergie débordante. Flow mitraillette, beats entre 180 et 300 bpm, twerks dans tous les sens : la température est montée d’un cran. Le IOMMa est bel et bien lancé.
Mercredi 4 juin : On se retrouve à la Cité des Métiers pour une journée d’échanges, de conférences et de rendez-vous pro. Le matin commence fort, avec une table ronde consacrée aux festivals de l’île Maurice — un vrai vivier musical, au cœur des dynamiques de la zone. Les discussions se poursuivent autour de la plateforme Création Africa, avec les délégations africaines présentes. Le panafricanisme n’est pas un mot creux ici, il circule, il s’incarne. Pas étonnant de croiser Muthoni Drummer Queen, chanteuse kényane engagée, membre du jury cette année, après avoir enflammé la scène lors de l’édition précédente. Elle intervient sur les stratégies de développement pour les artistes dans l’espace de l’Océan Indien. C’est aussi l’occasion de croiser d’autres trajectoires inspirantes, comme celle de Divhia Batta, fondateur du festival Jodhpur RIFF en Inde.
Au Kervéguen, la soirée fait sens avec le parcours de Divhia entendu le matin, elle démarre avec Jatayu, venu tout droit de Chennai. Leur musique est un pont : jazz-funk électrique et traditions carnatiques. Une fusion maîtrisée et fiévreuse. Puis vient Emlyn, multi-instrumentiste et chanteuse mauricienne, nouvelle sensation de l’île sœur. La salle est pleine, et danse en trombe sur son sagaï, hérité du seggae de Menwar. Avec son groupe VannSiwa, elle propose une musique à la fois panafricaine, ultramarine et résolument engagée. À peine remis, on enchaîne avec Mashmanjaka et son reggae-dancehall malgache : un son brut, efficace, qui montre que l’île rouge n’a rien à envier à la Jamaïque. Les showcases se terminent avec la trap-maloya de Diff-Men. Il tisse l’héritage de son père – gardien du maloya acoustique – avec les sonorités d’Atlanta : trap, drill, et textes engagés. Il clôture avec un maloya dépouillé, presque chuchoté, porté par une voix entre vulnérabilité et appel aux ancêtres.
Jeudi 5 juin : Dernier jour du IOMMa. On élargit la focale, direction l’Asie du Sud-Est et l’Australie. Sur scène, dans les conférences, les voix s’élèvent pour parler de circulation, d’identité, d’économie. On écoute Olivier Araste, leader de Lindigo, livrer quelques fragments de son parcours. On échange sur les réseaux féminins, ces courroies de transmission puissantes. Elles accélèrent les changements dans une industrie qui se reconfigure. À l’image de la programmation du IOMMa et du Sakifo, les femmes incarnent aujourd’hui, avec brio, toute la diversité musicale du bassin indo-océanique. Et plus encore : elles en tracent l’avenir.
Le Sakifo, ouvre une nouvelle décennie, part belle aux artistes féminin et à la sono mondiale
La soirée du 5 juin inaugure la 21e édition du Sakifo. Sept artistes se relaient pour cette première soirée gratuite, miroir du IOMMa. Parmi eux, le groupe australien Black Jesus Experience imprime un ethio-jazz qui tangue entre spoken word, hip-hop et soul résonne comme une nu soul empreinte d’effluves sonores azmaris. Grèn Sémé emporte le public avec son maloya électronique, comme une faille spatio-temporelle activée par des synthés analogiques à la Stranger Things. Sauf qu’ici, la scène ne flotte pas dans le vide intersidéral, mais bien dans l’Océan Indien. Carlo de Sacco, chanteur et percussionniste, navigue entre poésie incantatoire et vertige électro. Quelques mètres plus loin, sur la scène Ti-Bird, posée face à la mer, P.L.L déclenche un véritable raz-de-marée. Une vague humaine, dansant, vibrant, sur son dancehall créole.
Durant les trois jours du Sakifo, pour cette première de la troisième décennie, plus de 58 artistes enchaînent les performances. Chaque scène a sa personnalité. Et les artistes féminines ont incarné, sans détour, la force motrice de cette édition. Elles sont là. Partout. Présentes, puissantes, inimitables.
Nagaï, magnétique, irradie d’un reggae volcanique, viscéral, trempé dans les racines. Son son roots dialogue avec la Jamaïque, Saintes-Croix et les grandes voix du reggae-roots. Lorsqu’elle reprend Dezarie en live, c’est toute une spiritualité qui se dresse. Ce qu’elle propose ? Un reggae réunionnais nouvelle génération, entremêlé de skank, de maloya ternaire et de cocottes de guitare façon soukous. Un son panafricain taillé pour la scène mondiale. Malaïka Salatis, elle, offre un show solaire, où la pop, l’afrobeat, le maloya et la danse fusionnent en un seul corps. Charismatique, libre, envoûtante. Sueilo, à peine descendue du IOMMa, retourne la scène Filaos. Son univers, subtil et hybride, passe avec une aisance bluffante du shatta à l’amapiano, de l’afrobeats au hip-hop. Elle incarne la nu-gen réunionnaise, celle qui parle plusieurs langues musicales sans jamais perdre le flow. Dans la nuit, Agnesca, reine rave de l’Océan Indien, prend le contrôle des platines. Ses sets sont des séismes : denses, frontaux, créoles. Une énergie qui amène le public, en transe ! Lisa Ducasse, venue de Maurice, propose tout autre chose : une poésie suspendue. Sa voix douce, son phrasé magnétique, dessinent une parenthèse de grâce au cœur du tumulte. Votia, fille de Gramoun Lélé, nous ramène au maloya ancestral. Elle enchante avec son album Vie Kaz, mémoire chantée et enracinée. Mélanie Péres, elle, propulse la scène électro-mauricienne dans un futur lumineux, entre machines, chant, hip-hop et tambour ravann. Et que dire de Kasiva Mutua ? Interdite de percussion dans son enfance, elle en a fait un art majeur. La Kényane cogne avec puissance, rythme et engagement. Sa batterie est un manifeste. Ces reines ne chantent pas seules. Elles transmettent. Elles portent. Comme une mère passe le feu à son enfant, elles élèvent la musique des Mascareignes et de l’Afrique vers un horizon universel.
Le Sakifo, incarnation du meilleur des musiques actuelles et de demain
Ce n’est pas un hasard si Fatoumata Diawara elle-même, icône du continent Africain, est venue émouvoir le public de la scène Salahin. Cette scène, justement, est la plus grande, le phare. Elle a vu défiler Tiakola et ses bangers, le nu-gospel vibrant de Faada Freddy, l’univers synthétique et poétique de Zaho de Sagazan, l’électro de Petit Biscuit. Et bien sûr, les talents locaux. Ceux qu’on verra bientôt sur plusieurs continents : le DJ Sedjem, Aleksand Saya et ses beats cosmiques, Kanasel et sa pop-soul qui groove.
On danse sur la Ti-Bird, les pieds dans le sable, les basses dans le sternum, avec vue sur les vagues. On bifurque vers la Poudrière, pour se faire bousculer par Les Limiñanas, Caballero & JeanJass, et une flopée d’internationaux. Le public, lui, vient de partout. Et comme on dit ici : « sé sa La Réunion ! » Et puis vient Etinsel Maloya. Gifle magistrale. Ils invitent Lindigo, ou encore l’équipe singeli tanzanienne de Man Fongo. Ce groupe incarne un futur du maloya : pur, brut, ancré. On se souvient de leur passage dans la salle Verte l’an passé — cette année, ils ont pris d’assaut les grandes scènes.
La salle Verte, parlons-en. C’est le cœur battant du Sakifo. Son foyer. Là où le maloya se vit à hauteur d’âme, là où l’on danse comme autrefois, au son de Flambola ou Kiltir. Un lieu-tresse, un socle musical, un point rural vibrant.
L’essor de l’électro-trad tropicale
L’un des fils rouges de cette édition, c’est ce groove mutant, cette hybridation organique-machine. L’électro-trad tropicale. Ce n’est plus une tendance : c’est une école.
Chaque artistes et groupes sculptent des fusions entre autotune, percussions, kayamb. Le Sakifo rassemblent des laboratoires musicaux propulsant des hybridations de musiques
Le IOMMa et le Sakifo 2025 ne se contentent pas de proposer une programmation éclectique. Ils nous tendent un miroir. Ils reflètent des dynamiques profondes : la place centrale des artistes féminines, l’émergence de sons nouveaux, l’importance de la mémoire et du lien aux ancêtres.Dans les machines, dans les voix, dans les transes et les silences, une mutation est en cours. Une sono-mondiale renouvelée, vivante, joyeuse et insoumise.
La troisième décennie du Sakifo commence. Et pour reprendre Nagaï, elle sera volcanique.
Nartrouv’ en 2026 !














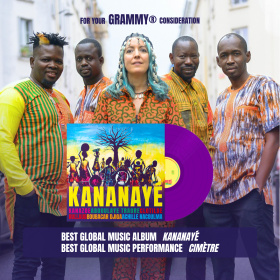









Commentaires
s'identifier or register to post comments